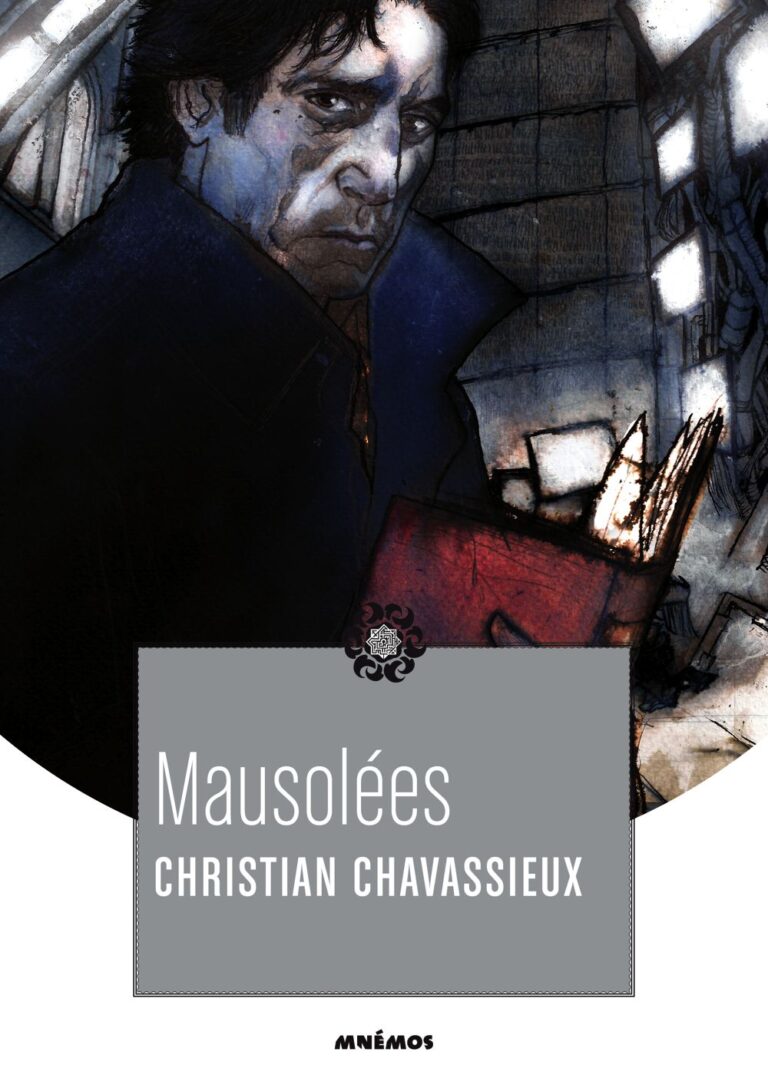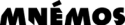Christian Chavassieux sur Je suis le rêve des autres
À l’occasion de la sortie de son roman Je suis le rêve des autres, Christian Chavassieux répond à nos questions.
Auteur à la plume libérée des genres, vous publiez depuis de nombreuses années aussi bien en blanche, en historique, en polar et en imaginaire. Né en 1960, vous avez publié votre premier roman en 2008, une fantasy kafkaïenne. Comment sont nés ce roman et votre arrivée dans la littérature ?
Bonjour et merci. J’aime bien l’expression « fantasy kafkaïenne » pour qualifier Le Baiser de la Nourrice. Le magazine « Le Matricule des Anges » avait parlé de « roman poélitique », qui cerne aussi pas mal l’enjeu littéraire de cette publication inaugurale. Vous imaginez bien qu’un premier roman édité à l’âge de 48 ans est précédé de pas mal de tentatives. En fait, j’ai toujours écrit des romans, mais sans projet d’édition, juste parce que c’était mon mode d’expression, avec la BD. J’avais publié une bricole sous pseudo pour un autre auteur, j’avais écrit des nouvelles qui avaient été primées dans des concours et Le Baiser était, je crois, mon quatrième manuscrit assez abouti pour être proposé. Parmi les « tentatives » se trouvait un tout premier roman intitulé À la Droite du Diable qui deviendrait Mausolées chez Mnémos beaucoup plus tard. Je suis donc « arrivé » en littérature par Le Baiser… un court texte violent, dérangeant. J’avais conçu cette farce odieuse comme un exercice de style, une plongée en apnée dans une piscine de cafards, avec la conviction que personne ne voudrait d’une horreur pareille. Et finalement, c’est ce texte qui m’a valu des contacts d’éditeurs, des retours intéressés. Le premier à s’engager vraiment a été Jean-Patrick Péju, directeur d’une collection chez JP Huguet appelée « Les Sœurs océanes ». J’avais lu, de deux de ses autrices, des textes puissants, très durs, dans quoi je reconnaissais une parenté avec le mien. J’ai donc tenté ma chance. Une semaine après le dépôt, mon manuscrit était accepté. Il a été sélectionné pour plusieurs prix et m’a un peu catalogué comme un auteur difficile, amateur d’histoires bizarres. Je me souviens que j’en parlais très mal, aux journalistes je disais : « C’est affreux, c’est noir, c’est fait pour décourager le lecteur… » Je me suis un peu calmé aujourd’hui. Pas sur le fond, mais comme je sais parfaitement faire ressentir la cruauté et la violence, ça ne m’intéresse plus et j’essaye d’échapper au procédé habile pour aller me risquer sur d’autres terrains. Raconter la tendresse, c’est difficile aussi.
Quelques années plus tard, vous voilà récompensé par le prix Lettres-Frontières pour L’Affaire des vivants chez Phébus et Planète-SF pour Les Nefs de Pangée chez Mnémos. Le premier est un roman historique quand le second appartient à la science-fiction. Naviguer entre les genres semble donc être votre marque de fabrique. Comment l’expliquez-vous ?
Selon moi, L’Affaire des Vivants n’est pas un roman historique parce que le 19e qui y est décrit en est une idée, il est nourri d’autant de littérature que de documentation, et Les Nefs bascule de la fantasy à la SF. Noir Canicule a été vendu comme un polar, alors qu’il explore l’anonymat des masses et décrit l’Apocalypse. Pour chaque livre, même pour les essais, qui sont d’habitude soumis à un cadre normatif, je bifurque, je m’évade… Ce n’est même pas par souci d’originalité, c’est qu’autrement, je m’ennuierais. Et puis, je crois que je ne sais pas écrire de roman, en vérité. J’essaye. Chaque livre est un prototype, ce qui pose problème pour lecteurs et éditeurs. Cette problématique des genres, c’est un peu ma plaie. Je ne sais pas, je n’y fais pas attention. J’écris ce qu’il me semble important d’écrire. Mon travail, c’est la phrase. Alors, le genre… C’est inévitable, je sais bien. Il se trouve que certains thèmes inspirent une certaine musique et quand j’amorce le récit, la musique est lyrique ou sèche, symphonique ou minimaliste, Jean Sibelius ou Philip Glass. Et là, je sais que j’entre dans un récit de telle ou telle nature, ou plutôt qu’on en dira : « c’est tel genre ». Bon, si vous voulez. Je veux dire que ce n’est pas une volonté de ma part, pas un choix délibéré. Pour traiter des thèmes qui infusent Les Nefs, il n’y avait aucun cadre historique adapté : la fantasy s’imposait. Pour suivre les deux personnages de Je suis le rêve des autres, l’imaginaire n’était pas une absolue nécessité, mais dès les premières pages, ils se sont aventurés sur une lande dépouillée qui m’évoquait Conan ou ce que j’avais construit pour Les Nefs. Et au fil de l’écriture, ce choix s’affirmait, donnait plus de corps, plus d’écho à mon histoire. Foladj et Malou respiraient tellement bien dans cet univers !
Cette transversalité vous fait arriver au sein du label Mu chez Mnémos, le 18 mars prochain, avec un nouveau roman Je suis le rêve des autres. Il semble que ce dernier soit dans le même univers que Les Nefs de Pangée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
D’abord, disons tout de suite qu’il n’est pas nécessaire d’avoir lu Les Nefs pour apprécier Je suis le rêve des autres. Ceci dit, après Les Nefs je suis passé à autre chose, j’ai beaucoup écrit, beaucoup été refusé, je me suis consacré à des essais, des romans contemporains (Phébus en publie un en mai, d’ailleurs). Le monde des Nefs était à disposition, comme en réserve ; j’étais loin de l’avoir exploré entièrement, mais je n’aurais pas pu inscrire un récit dans ce cadre, uniquement pour le plaisir d’y revenir. Il me fallait une histoire que l’univers de Pangée magnifierait. Sur ce vaste continent, au fil de son immense fleuve majeur, ce monde était idéal pour un grand récit de voyage. Dans le personnage de Foladj, un vieux baroudeur revenu de tout, un des rares aventuriers de son village, j’ai vu l’acteur du dernier acte d’un monde disparu. Or, Les Nefs de Pangées’achève par l’effacement d’un monde au profit de l’avènement d’un autre. Pour faire bonne mesure, et que les transformations soient actées (définitivement ?), j’ai placé le récit de Je suis le rêve des autres mille ans après les événements racontés dans Les Nefs. Nous marchons sur les restes d’une civilisation qu’on peut croire éteinte, mais comme le disait Hammassi la conteuse des Nefs : « Ce qui paraît perdu à jamais résiste mieux qu’on le croit aux changements les plus radicaux. Tout demeure. Rien n’est absolument détruit. Mais nous ne vivons pas assez vieux pour en faire le constat et en être rassurés. C’est cela, le drame de notre condition. » Je vous propose un saut dans le temps assez grand pour vérifier cette hypothèse. Et une aventure humaine assez intime pour la rendre sensible. Tout cela dans un environnement grandiose parce que, écrit en partie pendant le confinement, j’avais soif de grands espaces.
Pour revenir à votre écriture, il est souvent fait mention, à raison, des qualités littéraires de vos romans. Alice Ferney, journaliste et autrice, a par exemple consacré un article sur L’Affaire des vivants en évoquant « un chef-d’œuvre ». Beaucoup vous découvre une plume, une voix qu’on n’oublie pas. À quoi cela, dans votre travail d’écrivain, est-il dû à votre avis ?
Si c’est vraiment le cas, j’en suis très heureux, parce que je travaille beaucoup pour obtenir un certain résultat. Voyons… Ça vient peut-être d’abord d’un complexe d’infériorité. Un parcours scolaire difficile m’avait convaincu que j’étais un cancre, nul en presque tout. Quand j’ai commencé à écrire « sérieusement », je veux dire avec la perspective d’être publié, je voulais montrer que je « savais » écrire. En gros, je me suis appliqué, j’ai fait du sous-sous-Proust, avec longue syntaxe chantournée, vocabulaire rare, formes sophistiquées, etc. C’était enflé, trop malin pour être honnête, sur-écrit. Je ne le regrette pas, parce que maîtriser la phrase longue est parfois un atout. Ensuite, comme la plupart des écrivains, je me suis efforcé d’aller vers plus de simplicité et d’efficacité. Si je m’adonne au baroque, au lyrique, ce n’est plus pour masquer ma médiocrité, c’est un choix (parfois ludique : il m’arrive de glisser secrètement des alexandrins dans mes romans).
Il y a aussi le vocabulaire. J’adore cette richesse. Sans être précieux, il existe parfois un mot, rare ou ancien, qui signifie précisément ce que vous avez en tête. Vous n’avez pas le choix : c’est celui qui doit être utilisé. Pour mes romans « historiques », j’ai toujours commencé par éplucher les dictionnaires contemporains de l’époque que j’allais décrire, avant toute autre recherche documentaire. Ensuite entre en jeu la sonorité des mots, l’équilibre et le rythme de la phrase. J’ai la chance que ma première lectrice lise à haute voix, ça me permet de vérifier la musicalité du texte, essentielle pour moi. Aussi, je pourchasse les lieux communs, les images déjà vues, les métaphores habituelles. Enfin, j’en parlais plus haut, mais voilà comment j’écris : aucun plan, chaque phrase m’entraîne vers la suivante. On pourrait considérer mes romans comme le cheminement de phrases qui ont fini, par accumulation et addition, par créer une histoire. Une phrase bancale peut me bloquer plusieurs jours. Je relis alors incessamment les pages qui précèdent pour comprendre en quoi elle cloche, pourquoi elle ne convient pas. Et vous savez quoi ? En général, c’est parce que cette phrase n’appartient pas à ce roman. Je ne veux pas dire que je l’ai piquée ailleurs, je veux dire qu’elle est étrangère au programme littéraire qui prévaut ici, dans ce que je suis en train de faire. Chaque roman a sa propre musique, son propre rythme, son énergie particulière. Voilà, je suppose qu’à force, ce processus induit une voix singulière.
Vous traitez souvent de la « fin » dans vos romans. Je suis le rêve des autres n’échappe pas à la règle, comme cela a été le cas avec Noir Canicule (disponible chez J’ai lu). Il y a également chez vous cette envie d’aller à la rencontre de l’autre, celui différent, qu’on aime… ou pas. La question est sans doute taquine, mais seriez-vous un humaniste nihiliste ?
Désespéré, oui ; nihiliste, je ne crois pas. Humaniste, on me l’a souvent dit, ce doit être vrai. Peut-être une question de génération… Il est difficile en ce moment de croire en l’humanité, n’est-ce pas ? J’écrivais il y a peu : « il m’arrive comme à tous, de chier sur l’humanité, de ne plus en pouvoir, de céder au désespoir vrai en la considérant, et puis, une musique, un tableau, un poème, et tout est réparé, tout est oublié, tout est pardonné. Les artistes nous consolent de la barbarie du monde et peut-être même nous sont-ils de splendides boucliers. » Je suis le rêve des autres évoque une humanité guère plus évoluée que la nôtre et pas beaucoup plus aimable. Cependant, c’est parmi les individus qui la composent que se trouvent les semences d’un regain, Foladj, Malou… de « splendides boucliers », qu’ils soient artistes ou pas. Ce sont ces personnes qui rendent la fin fréquentable et notre existence moins stérile qu’il y paraît. On est bien obligé d’être humaniste quand on assiste aux sacrifices de certains pour le bien de tous ou quand on découvre le travail de rédemption d’anciens criminels. Cette effarante beauté humaine qui vous impose, sporadiquement, d’écarter le confortable cynisme pour, au moins une fois, vous inspirer un engagement, un credo, une vision. Bah, oui : humaniste, bien obligé à cause de tels exemples, et désespéré parce que lucide, c’est le paradoxe.
Quant au thème de la fin, y a-t-il un roman intéressant qui ne l’explore pas ? L’enfance est la première partie de nous à mourir et certains ne parviennent jamais à en faire le deuil, et puis, les autres âges suivent… Le premier récit de l’humanité, L’Epopée de Gilgamesh, questionne la peur de mourir. Nous sommes inconsolables de cette conclusion inéluctable et l’angoisse qu’elle génère est la source des fables. À côté d’un tel ultimatum, même l’amour est une piètre consolation. Je ne vois pas ce qui me pousserait à écrire, sinon.
Cette question humaine, nous la retrouvons dans Je suis le rêve des autres avec la fin de l’enfance et celle de la vie, mais également dans le rapport entre les générations et de ce que nous laissons, en bien ou en mal, à celles et ceux qui nous succèdent. Comment avez-vous abordé l’écriture de ce roman ?
Il y avait ce plaisir de regarder vivre et se côtoyer deux êtres complices au-delà de leurs différences : un vieillard à l’âge indéterminé, mais dont il est évident que ce voyage sera le dernier, et un enfant de 7-8 ans qui n’est jamais sorti de son village. Un dur à cuire et un rêveur, avant que les choses s’inversent. Comme les phrases dont je parlais plus haut, ce sont les rapports entre eux qui m’ont conduit. Bien sûr, il y a des péripéties, du danger, des surprises, mais je voulais rester au plus près de mes personnages, j’avais envie de les choyer, de leur donner l’occasion d’être beaux. J’ai écrit la plupart des pages qui les concernent (donc tout le bouquin, en fait) avec le sourire. Je crois que j’avais besoin de cette paix, de cette tendresse. Et puis, au-delà du « MacGuffin » cher à tonton Hitch (ici, l’examen face au conseil qui déterminera si l’enfant est ou non un messager des esprits), s’est dessiné un propos plus large, qui m’avait d’abord échappé et j’ai compris ce qu’était pour moi Foladj et pourquoi je m’y identifiais tellement, malgré la différence d’âge (je ne suis tout de même pas si vieux). Il m’a semblé reconnaître en lui la culpabilité dont l’humanité finissante, dont nous sommes les derniers représentants, devrait ressentir tout le poids. Comme Foladj, notre espèce entière a fauté, son passé est inexpiable et pourtant, les générations futures devront endosser cet héritage. Malou, l’enfant, ressemble à cette jeune humanité qui n’a rien demandé et se voit confier la responsabilité du futur. Il est possible que le mépris et la rage contre leurs ancêtres tiennent lieu de moteur aux jeunes, mais ce serait une nouvelle façon de fauter. Ils devront faire la paix avec ceux qui les ont précédés et, sans les absoudre, tenter de comprendre pour ne pas reproduire. Je ne pense pas qu’aucune génération jusque là ait reçu à ce degré un tel défi.
Vous avez publié une dizaine de livres en vingt ans et êtes désormais un auteur reconnu pour toutes les qualités que nous venons d’évoquer. Phébus, Mnémos et maintenant Mu. Pourquoi avez-vous fait ce choix de publier Je suis le rêve des autres au sein de ce label ?
(Permettez-moi d’ajouter les excellentes éditions du Réalgar, qui font un travail remarquable en poésie, nouvelle et roman). Je dois dire que je suis particulièrement fier d’être intégré à la collection d’auteurs et d’autrices de Mu. Chaque livre y est original, particulièrement abouti, singulier.
En fait, c’est Frédéric Weil, de Mnémos, à qui j’avais adressé le manuscrit (en toute logique, puisque sa maison avait édité Les Nefs de Pangée), qui m’a proposé cet « aiguillage ». J’ai vu les superbes couvertures de Kévin Deneufchatel, lu plusieurs titres, et une évidence s’est imposée : Je suis le rêve des autres, serait au mieux sous ce label. Il correspond parfaitement au profil de ce texte : une recherche en marge des genres, un goût pour un rythme inhabituel, une relative brièveté et pour les voix singulières. Je n’ai donc pas précisément choisi, mais si j’avais eu à le faire, c’est bien là que j’aurais envoyé ce manuscrit. En plus, tout s’est admirablement passé, entre le travail éditorial, l’illustration de couverture, les contacts… J’en profite pour remercier Patrick Mallet grâce à qui le texte a trouvé ses accents définitifs et Davy Athuil, pour m’avoir accepté et parce que je conserve toujours une grande admiration pour le travail des éditeurs (ceux qui voient là de la vile flatterie n’ont simplement pas ma chance).
Avec ce roman, une dernière question nous brûle le clavier : quels sont les rêves des autres que vous souhaiteriez faire ?
Tous les rêves élevés sont enviables. Élevés, c’est-à-dire généreux et nobles. Les rêves passés, venus d’ailleurs, les vaticinations, les espoirs, les mythes qui en sont une expression. Les rêves de littérature. Oui, ceux qui élèvent et troublent, orientent le regard vers une destination jamais pensée. Je ne rejoins pas cette idée selon laquelle nous serions les acteurs d’un rêve, qu’il soit issu d’intelligences artificielle ou divine. Les rêveurs, c’est nous, et nos songes ne s’évaporent pas tous au contact du jour. Ils subsistent et nous sont parfois une langue commune, qu’on la nomme littérature ou embrassade.
Et vous, avez-vous un dernier mot à ajouter ?
J’ai beaucoup aimé écrire Je suis le rêve des autres, j’ai aimé traverser les jours en compagnie de mes personnages. Ils m’ont souvent ému. J’espère que les lecteurs aimeront emprunter leurs pas et les imaginer poursuivre leur voyage, une fois le livre refermé.

Nos derniers articles
Christian Chavassieux